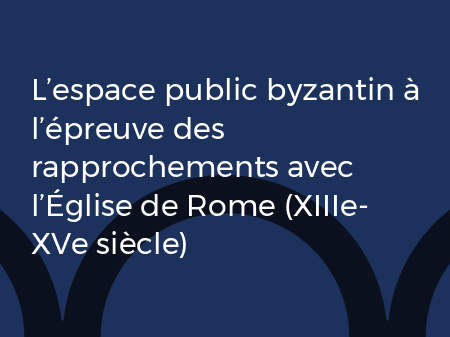
L’espace public byzantin à l’épreuve des rapprochements avec l’Église de Rome (XIIIe-XVe siècle)
From 11/05/2026 to 12/05/2026
Jean-Marc Besse (CNRS-UMR Géographie Cités)
La recherche proposée part d’une question : au-delà du regain d’intérêt actuel pour les atlas qui s’exprime dans les différents travaux qui s’y consacrent, peut-on dégager une convergence, et, plus exactement, quelque chose comme une forme commune sous-jacente à des productions qui se développent pourtant dans des registres assez diversifiés ? Plus généralement, les interrogations sur l’atlas permettent-elles de faire apparaître une structure à la fois transversale et fondatrice dans les cultures scientifiques et artistiques modernes ?
Face à cette question, la recherche proposée met en œuvre une hypothèse principale : le point commun de ces diverses investigations, c’est, semble-t-il, un intérêt pour la forme de l’atlas lui-même, ou, plus précisément dit, pour l’atlas comme forme graphique et éditoriale de création, visualisation et d’organisation des connaissances, des images, et des objets. Le projet de recherche envisagé ici se développe selon deux directions principales :
1 - Les recueils d’estampes cartographiques d’Antoine Lafréry et de ses héritiers
On propose une investigation autour des recueils d’estampes cartographiques italiens, romains principalement (« atlas composites » ou atlas IATO/Italian Assembled To Order), composés entre 1560 et la fin du siècle par Antoine Lafréry (1512-1577) et ses héritiers. En prenant ces recueils comme lieu d’observation, il s’agit d’une enquête sur les origines de cette forme particulière d’archivage, de conservation et de présentation de l’information géographique qu’est l’atlas.
Les historiens de la cartographie, mais aussi les historiens des sciences, réduisent trop souvent les origines de l’atlas à deux noms principalement, Abraham Ortelius et Gérard Mercator, qui auraient été les « inventeurs » de la formule graphique appelée, à la suite de la décision de Mercator : « atlas ». Il s’agirait ici, au contraire, de restituer la complexité des contextes de production, de diffusion et d’utilisation de ces atlas ou recueils cartographiques à l’intérieur de l’espace européen.
Antoine Lafréry (ou Lafreri) est l’un de ces acteurs. Installé à Rome dans le milieu des années 1540, ayant absorbé l’activité d’Antonio Salamanca en 1563, il est devenu le principal imprimeur-éditeur d’estampes de la ville. Dans les années 1572-1573, il fait graver un frontispice qu’il ajoute aux recueils de cartes qu’il réalise sous forme reliée à la demande de ses clients, et rédige un catalogue ordonné de son stock cartographique : il crée un objet nouveau sur le marché italien de l’estampe. Ces recueils rencontrent un grand succès et l’on peut considérer qu’ils constituent une alternative aux productions d’Ortelius et de Mercator.
Les conditions de la composition des recueils donnent à la production de Lafréry un caractère particulier. Ses « atlas » sont assemblés dans le cadre d’une « négociation » entre l’imprimeur-libraire et une clientèle dont les moyens, les goûts, les intérêts peuvent varier. Ainsi, même si l’on peut constater un phénomène de standardisation progressive des productions après 1580, à l’initiative de l’héritier de Lafréry, son neveu Claude Duchet, chaque assemblage peut être considéré jusqu’à un certain point comme unique, aussi bien dans son contenu quantitatif et qualitatif que dans son ordre. Au bout du compte, le recueil de cartes apparaît moins comme un objet au sens restrictif du terme (stabilisé et homogène), que comme un lieu de transactions savantes, commerciales et symboliques, lieu nécessairement instable. Un lieu qui appelle une approche historiographique renouvelée, tenant compte, justement, des contextes pragmatiques et spatiaux à l’intérieur desquels la forme-atlas est élaborée, développée, et mise en circulation.
Les objectifs de cette recherche, qui suppose la mise en place de collaborations avec des bibliothèques en Italie et en France, sont les suivants :
L’enjeu scientifique de cette première direction de la recherche se décline à partir de quatre questions :
2 – L’atlas comme forme graphique dans la culture moderne
A l'articulation de l'histoire de la cartographie, de l'histoire du libre, de l'histoire de l'estampe et de l'histoire des formes graphiques de présentation des objets scientifiques et artistiques, la seconde direction de ce projet de recherche a pour ambition d'interroger la naissance, le développement et la stabilisation, dans la culture européenne moderne, dun espace de constitution de l'objectivité: l’atlas, considéré ici comme une forme graphique de visualisation, de conservation, d’organisation et de construction des connaissances, mais aussi comme un dispositif tout à la fois matériel et intellectuel destiné à rendre possible et à organiser la lisibilité du monde.
C’est d’une histoire « matérielle » qu’il s’agit, une histoire des instruments et des formes de présentation visuelle de l’information géographique, scientifique et artistique de façon plus générale. Plus exactement, l’objectif est celui d’une histoire critique de la constitution et des transformations (à la fois formelles et dans les usages) d’un espace graphique spécifique, qu’on appellera un dispositif.
Dans la perspective de cette histoire matérielle de la constitution d’un espace graphique, il s’agit avant tout d’étudier un geste, ou plutôt un ensemble de gestes pour la plupart non discursifs. Ces gestes non verbaux ont néanmoins le pouvoir d’organiser de manière durable à la fois le champ du visible et le champ du discours. On voudrait, dans le cadre d'une bhistoire culturelle des formes visuelles, envisager l'atlas dans la perspective de cette interrogeation sur les microtechnologies intellectuelles et matérielles (M. de Certeau) qui qui sous-tendent la constitution des espaces cognitifs, c’est-à-dire à la fois visuels et discursifs, dans la géographie mais aussi d’autres champs de savoir.
Page translated from French, last update //
Programmes structurants (2022-2026)Axe 1 – Espaces maritimes, littoraux, milieux insulaires Axe 2 – Création, patrimoine, mémoire Axe 3 – Population, ressources, techniques
Axe 4 – Territoires, communautés, citoyenneté
Axe 5 – Croyances, pratiques et institutions religieuses Axe 6 – L’Italie dans le monde |
Projets financés par l'Agence nationale de la Recherche (ANR)Axe 2 – Création, patrimoine, mémoire
Axe 3 – Population, ressources, techniques Axe 4 – Territoires, communautés, citoyenneté
Axe 5 – Croyances, pratiques et institutions religieuses
Axe 6 – L’Italie dans le monde
|
Projet franco-allemand financé par l'Agence nationale de la Recherche (ANR) et la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)Axe 6 – L’Italie dans le monde
|
Projets européens (Horizon 2020)Axe 1 – Espaces maritimes, littoraux, milieux insulaires
Axe 5 – Croyances, pratiques et institutions religieuses |
Projets ImpulsionAxe 2 – Création, patrimoine, mémoire
Axe 3 – Population, ressources, techniques
Axe 4 – Territoires, communautés, citoyenneté
Axe 5 – Croyances, pratiques et institutions religieuses
|