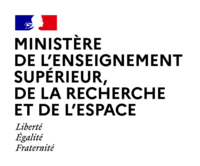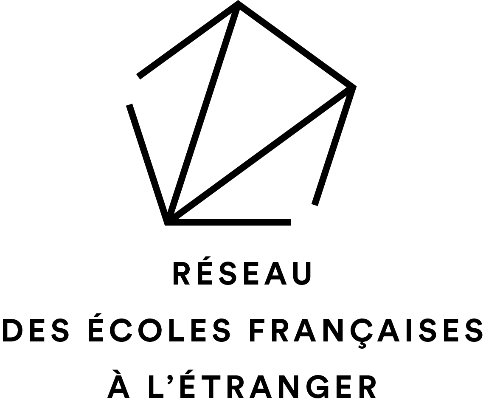Le calendrier des Lectures méditerranéennes 2025
From 10/13/2025 at 18 h 00 to 11/03/2025 at 20 h 00
| Cliquez ici pour écouter le podcast des trois conférences |
Pour la neuvième édition des Lectures méditerranéennes, l'École invite à Rome Dionigi Albera, anthropologue et directeur de recherche émérite au CNRS, qui tiendra trois conférences sur le thème « Dans les interstices des religions. Dévotions partagées en Méditerranée ».
À l’occasion de la présentation de l’exposition « Lieux saints partagés » à la Villa Médicis (octobre 2025-janvier 2026), dont Dionigi Albera est l’un des commissaires, le cycle de conférences se concentre sur un horizon thématique qui demeure encore peu connu, même s’il a déjà fait l’objet de plusieurs explorations scientifiques.
Sa généalogie remonte loin dans le temps. Déjà dans les premières décennies du XXe siècle, quelques travaux savants s’étaient concentrés sur les relations entre chrétiens et musulmans dans l’Empire ottoman. Mais c’est surtout au cours des dernières décennies que l’on a assisté à un regain d’intérêt pour l’étude de la fréquentation conjointe des mêmes sanctuaires de la part de fidèles se rattachant à des traditions religieuses différentes. Maints travaux historiques et anthropologiques ont montré le caractère récurrent, dans plusieurs secteurs de la Méditerranée, de ces comportements qui déjouent, au moins partiellement, les frontières entre les religions monothéistes.
Le cycle propose un regard d’ensemble sur de tels phénomènes, accompagné d’une série d’approfondissements concernant certaines situations particulières. Se dessine ainsi un itinéraire inédit dans un paysage étonnement pluriel.
Ces trois conférences seront, comme à l'accoutumée, accueillies par les partenaires romains de l'École française de Rome, dans des lieux exceptionnels.
PROGRAMME
- Lundi 13 octobre 2025, 18 h, Ambassade de France en Italie / Institut français Italia, Palais Farnèse, Salon d'Hercule (piazza Farnese 67)
Lampedusa, une île entre deux mondes
Depuis quelques décennies, Lampedusa évoque les traversées maritimes en Méditerranée. Son nom est associé à un triste chapelet de tragédies et de détresse humaine, à une comptabilité accablante de naufrages, de morts et de rescapés. L’île semble affleurer d’un passé brumeux seulement à partir du moment où les réflecteurs de l’actualité l’ont cernée. Pourtant, il existe bien une Lampedusa avant « Lampedusa », pour ainsi dire.
Aussi loin qu’on puisse remonter dans le temps, on constate que Lampedusa est un carrefour maritime important, un nœud essentiel de la circulation humaine en Méditerranée. De surcroit, un dispositif symbolique étonnant surgit ici, à partir au moins du XVIe siècle. Une petite grotte, cachée dans les plis du territoire, accueille un culte singulier. Une moitié est réservée à la vénération d’une image de la Vierge, l’autre à celle d’un saint musulman, dont elle abrite le tombeau. Les nombreux marins qui font escale sur l’île ne manquent jamais d’honorer ce petit sanctuaire et d’y déposer des offrandes qui seront utilisés par les esclaves fugitifs et par les naufragés, sans distinction de religion. Pendant plusieurs siècles, l’île se configure ainsi comme un espace de rencontre pacifique et de solidarité entre ennemis, dans une mer hantée par des antagonismes obstinés et des heurts belliqueux.
Cette étonnante cohabitation interreligieuse devient bientôt familière au public cultivé en Europe. Grace à une vaste production écrite, le mythe de Lampedusa voyage à travers le continent et, au XVIIIe siècle, attire l’attention de plusieurs protagonistes des Lumières. La petite île est ainsi identifiée comme « un haut lieu de l'entraide et de la tolérance en Méditerranée ».
Lampedusa renoue aujourd’hui avec son ancienne vocation d’espace de transition et de contact. Des échos de l’ancien mythe resurgissent et se glissent dans le présent, inquiet et contradictoire, qui hante cet écueil égaré en pleine mer.
- Lundi 20 octobre 2025, 18 h, Académie de France à Rome - Villa Médicis (Viale della Trinità dei Monti, 1)
Lieux saints en Méditerranée : entre partage et partition
A première vue, l’idée qu’un lieu saint puisse être partagé par des fidèles de religions différentes pourrait apparaître incongrue, surtout dans un horizon monothéiste. L’allégeance exclusive à un dieu unique semblerait dans ce cas empêcher tout dépassement de la frontière religieuse.
Pourtant, comme un courant d’études récentes l’a bien montré, au cours des siècles le paysage religieux de la Méditerranée a été marqué par un foisonnement de manifestations de convergence interconfessionnelle dans les mêmes sanctuaires. Dans plusieurs cas, ces formes d’imbrication interreligieuse se prolongent encore dans le présent. La conférence s’appuiera sur l’examen de quelques exemples pour développer des réflexions plus générales.
La Mer intérieure a vu, tout au long de son histoire, une forte contiguïté entre populations de religions différentes. Elles se sont souvent connues, fréquentées et ont vécu dans une étroite proximité. Au demeurant, le voisinage n’est pas seulement physique. Il existe un paysage commun aux trois religions du Livre, caractérisé par une série de renvois, de porosités, de superpositions d’une tradition à l’autre, avec notamment la présence de plusieurs éléments transversaux (conceptions, valeurs, croyances, épisodes, mythes, rites, personnages saints, etc.). Le partage des lieux saints s’inscrit dans cette conversation rapprochée entre les religions monothéistes dans le pourtour méditerranéen.
La propension pour la convergence se heurte à l’action d’une tendance opposée, marquée par des efforts de séparation. On assiste ainsi à la constitution de groupes distincts à partir d’un horizon théologique imbriqué. Avec leur généalogie commune, les religions monothéistes forment une famille bagarreuse, où chaque membre est convaincu de détenir la vérité exclusive. La gémellité qu’on entrevoit chez les voisins peut engendrer la peur d’une désagrégation identitaire : la distinction doit être entretenue, l’autre doit demeurer Autre. Ainsi, même lorsqu’elle est microscopique, la différence est mise en avant et les frontières doivent être constamment renforcées : toute une armée de spécialistes religieux s’y est employée au cours des siècles. Le partage a ainsi été entravé, sans pourtant être jamais complétement immobilisé, par son double sombre et sévère : la partition. Par conséquent, la fréquentation commune de certains sanctuaires dans lesquels plusieurs religions se reconnaissent cède parfois la place à la division de ces lieux.
- Lundi 3 novembre 2025, 18 h, Institut français - Centre Saint-Louis (largo Toniolo, 20-22)
Marie des deux rives
Parmi les figures qui peuplent l'imaginaire du christianisme, Marie est certainement l'une des plus riches et des plus complexes. Elle condense des strates culturelles accumulées au cours des millénaires, continuellement réactivées, renouvelées et enrichies. Sous son manteau, la Vierge accueille d'innombrables symboles, des contenus théologiques cruciaux, des subtilités dogmatiques, des variations iconographiques infinies. Et aussi des pratiques dévotionnelles hétérogènes et disséminées.
Le rayonnement de cette figure contradictoire franchit les frontières du christianisme. On peut évoquer, à ce propos, la continuité, souvent soulignée, avec les déesses de l'Antiquité ou avec Isis. Au demeurant, les réverbérations de la figure de Marie en dehors du contexte chrétien sont particulièrement significatives par rapport à l'islam.
Marie occupe une place importante dans le Coran, étant le seul personnage féminin identifié avec un nom propre, tandis que toutes les autres femmes sont désignées comme une fille, une épouse, une mère ou une sœur d'un homme. De plus, la récurrence du nom de Marie dans le Coran est supérieure à celle que l’on retrouve dans l'ensemble du Nouveau Testament (34 cas contre 19). En particulier, Maria est une figure importante dans deux sourates (3 et 19). Selon la tradition musulmane, ces deux sourates auraient figuré parmi les plus chères au prophète.
Cette dimension symbolique et narrative ne peut être disjointe des comportements rituels et des localisations d'épisodes significatifs. La topographie islamique de Marie a investi de nombreux sanctuaires chrétiens, cette fréquentation étant surtout liée à un souci d’efficacité, à des demandes concrètes d’aide et d’intercession. La conférence proposera une exploration de quelques hauts lieux mariaux qui, au fil des siècles, ont accueilli des multitudes de dévots musulmans.
INFORMATIONS PRATIQUES
Conférences en italien.
Entrée gratuite, avec inscription obligatoire pour les deux premières conférences.
Lundi 13 octobre 2025, 18 h, Ambassade de France en Italie / Institut français Italia → Billetterie (gratuit sur réservation)
Lundi 20 octobre 2025, 18 h, Académie de France à Rome - Villa Médicis (Viale della Trinità dei Monti, 1) → Billetterie (gratuit sur réservation)
Cycle organisé par l'École française de Rome en partenariat avec l'Ambassade de France en Italie, l'Institut français Italia, l'Académie de France à Rome - Villa Médicis et l'Institut français - Centre Saint-Louis .