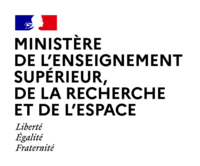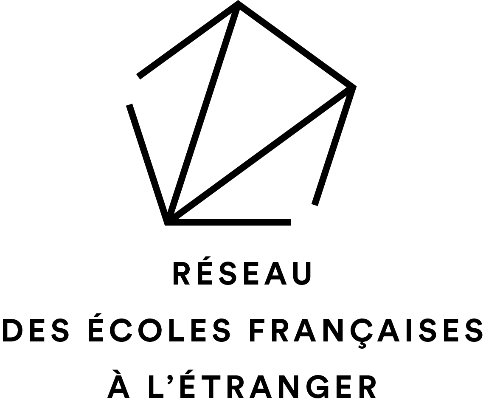COMMUNAUTES. À la recherche des communautés du Haut Moyen Âge : formes, pratiques, interactions (VIe-XIe siècles)
- Sections : Moyen Âge
- Responsables : Geneviève Bührer-Thierry, professeure à l’université Paris1-Panthéon-Sorbonne, LAMOP UMR 8589 ; Cristina La Rocca, professeure à l’université de Padoue, directrice de l’École doctorale d’Histoire-Géographie-Anthropologie de Venise-Padoue-Vérone
Présentation
Nous focaliserons l’attention sur les petites communautés qui reposent sur des pratiques communes à une échelle locale ou régionale, en cherchant quels en sont les éléments constitutifs. La notion exogène de « communauté » permet d’orienter la réflexion non vers son « essence », mais vers les modalités de sa mise en œuvre (à travers l’espace vécu, la construction de la mémoire, etc.) et d’évaluer si l’expression de son identité est consciente ou si elle est créée par un agent extérieur (comme le fait de payer la même taxe, ou de devoir se battre etc.).
Un bilan de l’historiographie permet de constater deux orientations principales : celle qui identifie des communautés religieuses à l’intérieur de la société ; celle qui étudie l’institutionnalisation des communautés. Si les communautés ne représentent jamais des personnes morales avant le XIIe siècle, néanmoins certains historiens n’hésitent pas à parler de « communautés » dès le haut Moyen Âge, en relation avec le territoire et avec l’émergence de la seigneurie. W. Davies utilise le concept de community territory pour souligner le fait que la propriété paysanne n’est pas une série d’isolats mais constitue un réseau d’interrelations.
L’intérêt scientifique d’une telle étude repose sur la discussion des concepts issus des sciences sociales comme la notion flexible de « communauté de pratiques » (E. Wenger) : les membres d’une communauté sont progressivement « formés » à travers leur participation de plus en plus complète aux activités du groupe. Leurs interactions avec les membres expérimentés les transforment progressivement en membres à part entière, capables à leur tour de former de nouveaux membres. Nous envisagerons aussi les modes de construction mais aussi de dissolution/destruction des communautés : construction par la norme, par des processus d’exclusion et d’inclusion, par la constitution d’une hiérarchie. On abordera enfin la question - cruciale – des communautés idéelles : l’étude des discours qui légitiment la communauté éclairera la manière dont elle se représente, se reproduit, transmet sa propre mémoire et oriente la construction des identités des sujets qui la composent.
Le projet a déjà réuni trois rencontres dont on trouvera les programmes ci-dessous et qui sont en cours de publication aux éditions Brepols (collection Haut Moyen Âge). La prochaine rencontre aura lieu à Farfa en octobre 2019 autour du thème : « Agir en commun ».
Liens
- Programme du colloque sur les Communautés maritimes et insulaires du premier Moyen Âge (10-11 mars 2017)
- Programme du colloque sur les communautés menacées au haut Moyen Âge (28-30 septembre 2017)
- Programme du colloque sur la Mémoire et communautés au haut Moyen Âge VII-XIIe siècle (13-15 septembre 2018)
Partenaires
France
- Université de Lille III
- Université du Littoral-Boulogne-sur-Mer
- Université Lyon II
- Université Paris1-Panthéon-Sorbonne, LAMOP UMR 8589
- Université Paris-Ouest-Nanterre
- Université de Reims
- Institut universitaire de France
Italie
Allemagne
Calendrier des opérations
- 10-11 mars 2017 à Boulogne-sur-Mer : « Communautés maritimes et insulaires dans le haut Moyen Âge »
-
28-30 septembre 2017 à Tübingen (Eberhard Karl Universität) : « Les communautés menacées au haut Moyen Âge »
Page mise à jour le 15/05/2019